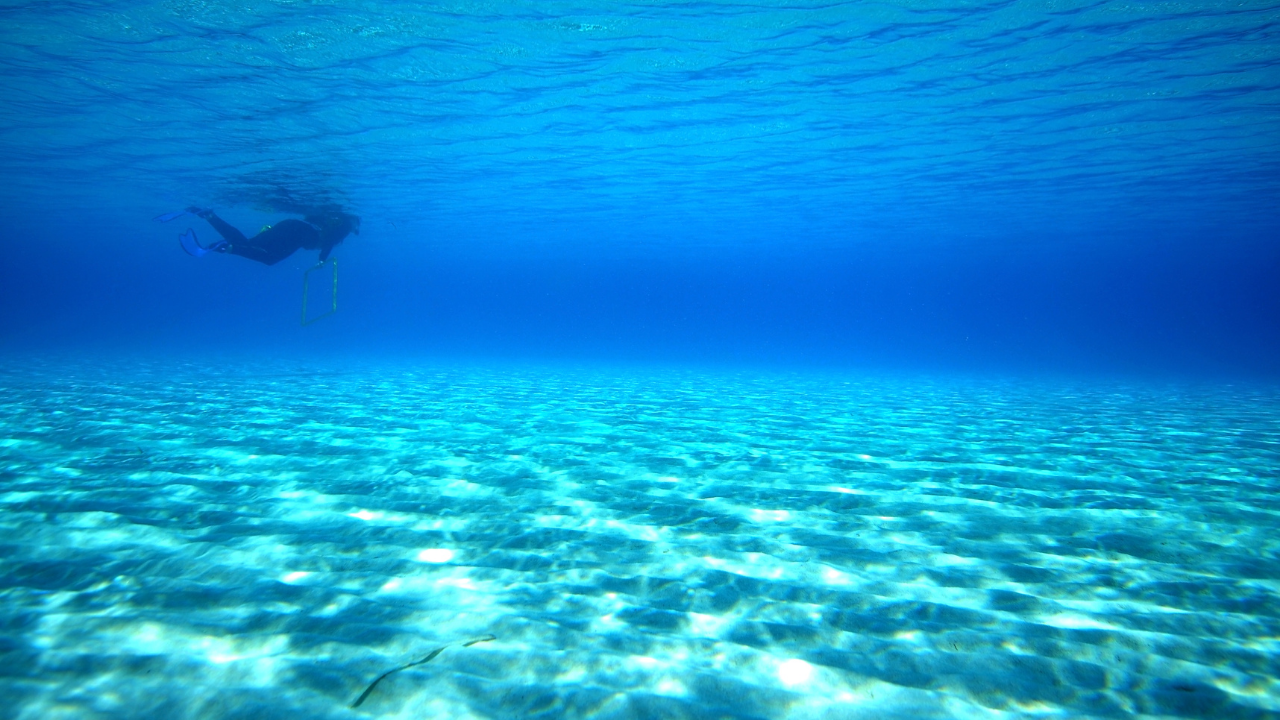L’essor industriel au cœur des enjeux en Afrique de l’Ouest est aujourd’hui une priorité stratégique pour les gouvernements et les acteurs économiques de la région. Face aux défis du développement et à la nécessité de diversifier les économies, plusieurs pays …
Made in Africa
Le Maroc domine l’exportation de tomates
Une ascension fulgurante sur le marché mondial Grâce à des investissements stratégiques et une production optimisée, le Maroc domine l’exportation de tomates, s’imposant comme le troisième exportateur mondial. Cette montée en puissance résulte d’une croissance continue des exportations et d’une …
Notre success story: Maison Ahouë
L’équipe de Happy In Africa a eu la chance de rencontrer Chrystelle qui a fondé avec Patrick Maison Ahouë, qui proposera début avril 2022 sur leur site e-commerce et en magasin bio en France des produits 100% bio et équitables venant du Togo.
Chrystelle est Directrice de la Maison Ahouë et connaît tous les rouages du marketing digital. Elle est responsable de l’image de marque et assure le développement commercial en France. Patrick est quant à lui, Directeur des opérations, il assure le pilotage financier et la coordination de la stratégie globale de la Maison Ahouë. C’est l’expert en agribusiness et l’atout terrain en Afrique.
- Racontez-nous le début du projet et son histoire ?
J’ai connu Patrick à Lyon en France, en école de commerce. Après nos études, Patrick est reparti au Togo d’où il est originaire et a maturé une idée autour de la food et du bio au Togo et en Afrique. De retour en France, nous nous sommes retrouvés et il m’a fait part de son idée. À cette époque, je travaillais dans une boutique de luxe mais cette nouvelle aventure, pleine de sens et en relation avec l’Afrique, m’a tout de suite tentée.
La fille de mon associé Patrick porte le joli nom de Ahouefa, qui signifié en langue éwé, la langue du Togo « la paix dans la maison ». Ahouë signifiant maison et Fa la paix. C’est ainsi que tout naturellement, après de longues discussions, nous sommes tombés d’accord sur Ahouë et donc Maison Ahouë. Pour nous, « maison » a le sens de foyer, l’endroit où on se sent bien et chez soi.
2. Qu’est-ce que vous vendez ?
D’un côté, nous faisons de l’import de produit brut, bio et équitable comme du café vert, des fèves de cacao, du soja, des fruits frais, des jus, des amandes de cajou… Et de l’autre, nous transformons certains produits comme les jus, les fruits séchés, les cafés en grain et moulus, et les tablettes de chocolat.
Nous proposons du bio (label AB) et de l’équitable, c’est-à-dire que nous soutenons les producteurs en Afrique en leur apportant un appui technique, organisationnel et financier pour privilégier une confiance mutuelle et une relation durable avec eux.
Nos produits seront prêts à être vendus en avril 2022 en France et dans l’Union Européenne.

3. Sur quels critères choisissez-vous vos partenaires ?
Toute notre chaîne de valeur est labellisée bio, de nos producteurs en Afrique jusqu’à nos façonniers en France.
Nous travaillons directement avec des coopératives de petits producteurs qui sont labellisés bio. Si les producteurs ne sont pas labellisés bio, nous les accompagnons dans leur conversion. Il faut environ deux ans pour une conversion vers le bio.
4. Quel impact souhaitez-vous avoir sur le continent ?
En France, nous voulons promouvoir les produits du terroir africain et mettre en valeur le travail des producteurs africains, bien souvent dans l’ombre. En Afrique, nous souhaiterions apporter de la valeur en créant plus tard des usines de transformation et en formant des personnes sur place. Par exemple, au Togo, il est difficile de transformer des fèves de cacao en chocolat, en volume.
5. Comment voyez-vous Maison Ahouë sur le moyen et long terme ?
Nous allons démarrer avec une petite sélection de produits togolais puis élargir les origines avec la Tanzanie, Éthiopie, Burkina Faso et Côte d’Ivoire. Et enfin proposer d’autres produits du terroir africain : mélange de jus, épices…
Nous aimerions participer au salon Natexpo qui est le salon international des produits biologiques et nous aimerions que des agriculteurs togolais nous accompagnent pour promouvoir leur produit.


Les produits seront disponibles sur notre site e-commerce avec une livraison possible en France et en Union Européenne, dans des magasins de la région lyonnaise et par la suite dans la France entière.
Pour conclure, Maison Ahouë est une promesse d’engagement durable, éthique, responsable et solidaire. Notre volonté est de renforcer les chaînes de valeur des filières agricoles et biologiques, de l’Afrique à la France. Nous souhaitons donner une voix et un visage aux agriculteurs africains bien souvent dans l’ombre, tout en soutenant l’activité des entreprises locales françaises. Nous croyons en un avenir meilleur pour l’Homme et la planète, et faisons de notre mieux pour avoir un impact positif à notre échelle.
10 raisons de célébrer la toute première Journée des aires marines protégées (AMP) en Afrique
Le dimanche 1er août 2021, un consortium d’organisations sud-africaines sera le premier, au niveau mondial, à célébrer une journée dédiée à la conservation des zones océaniques critiques qui permettent à la vie marine de prospérer, de se reproduire et de se développer. Le long du littoral sud-africain, il existe 42 aires marines protégées (AMP) qui offrent des refuges décisifs pour les animaux et les plantes dans l’océan, et soutiennent également les communautés humaines.
« Alors que de nombreuses personnes sont conscientes de l’importance des zones terrestres protégées, telles que les réserves naturelles et les parcs à gibier, peu comprennent que le même niveau de protection peut – et doit – être accordé à notre vie océanique également », a expliqué le Dr Judy Mann, Stratège de Conservation à la SAAMBR (Association sud-africaine pour la recherche en biologie marine).
En Afrique du Sud, les AMP sont déclarées par le biais de la « Gestion Nationale de l’Environnement : Loi des Aires Protégées » et relèvent de la responsabilité du Département des forêts, des pêches et de l’environnement. Sur terre, l’Afrique du Sud protège 7,8% de notre superficie, alors que dans l’océan, ce n’est que 5% du territoire.
Pour souligner le rôle important que jouent les AMP dans la conservation de la biodiversité marine, le consortium d’organisations sud-africaines, passionnées par la protection de la vie marine et des personnes, a créé la « Journée des AMP » comme un moyen d’éduquer et d’inspirer les autres sur la bonne gestion de ces espaces protégés et mettre l’accent sur les avantages que procurent les AMP. Voici quelques-unes des raisons de célébrer la Journée des AMP le 1er août.
1. Elles assurent la biodiversité
Ils protègent une gamme d’écosystèmes marins qui abritent des espèces rares ou menacées, ainsi que des animaux et des plantes sud-africains uniques qui ne vivent nulle part ailleurs dans le monde. Ils protègent les habitats d’alevinage critiques pour les créatures marines et offrent un espace pour que les espèces de poissons résidentes augmentent en nombre et en taille, assurant une source de nourriture vitale pour les humains.
2. Elles soutiennent les pêcheries adjacentes
Les AMP permettent aux poissons d’augmenter en taille et en nombre et, avec le temps, ils se répandent dans les zones de pêche adjacentes. Ainsi, la pêche s’améliore sans mettre les espèces en danger.
3. Elles garantissent la santé des animaux marins
Grâce à la création d’AMP, les animaux marins sont génétiquement plus forts, ce qui signifie qu’ils peuvent mieux s’adapter aux changements de l’océan.
4. Elles protègent le patrimoine culturel
L’océan est un espace vénéré pour le nettoyage, le culte, l’inspiration et le rajeunissement, et en protégeant ces espaces, les pratiques traditionnelles peuvent continuer, reliant les générations actuelles aux racines culturelles.
5. Elles favorisent le tourisme
Ces zones sont des espaces inestimables pour les activités récréatives, notamment la plongée avec tuba, la plongée sous-marine, l’observation des baleines et la nidification des tortues, entre autres. Certaines AMP du pays sont des sites de plongée de renommée internationale, attirant des touristes dans la région.
6. Elles sont des salles de classe en plein air
Des élèves de la phase préparatoire aux étudiants de niveau supérieur, les AMP agissent comme des centres éducatifs pour l’apprentissage dans l’environnement, offrant une connexion directe avec le monde naturel.
7. Elles contribuent à la recherche
La qualité immaculée de ces zones de conservation donne une idée de ce à quoi ressemble la nature lorsqu’elle n’est pas touchée par l’homme. Cela constitue une base solide pour la recherche sur le monde naturel et les techniques de conservation nécessaires.
Irrigation d’un champ via L’AgroPad de Erik Tiam
Les prévisions concernant les effets du changement climatique suggèrent que l’Afrique pourrait perdre 47% de ses revenus agricoles d’ici à l’an 2100, tandis que les plus optimistes prédisent une perte de 6% seulement.
En plus de l’abscence de main d’oeuvre, de nombreux agriculteurs font face au changement climatique. Ce qui a un impact considérable sur leurs revenus. En vue d’aider les agriculteurs à y remdier, le camerounais Erik Tiam a conçu un système d’irrigation solaire qui permet de fournir de l’eau et de l’engrais à partir d’un téléphone portable.
Après avoir constater que le potentiel agricole du Cameroun était sous- exploité, Erik Tiam a eu l’idée de créer un dispositif appelé l’AgroPad. Il en est le concepteur.
L’AgroPad est un système qui allie nouvelles technologies et énergie solaire pour permettre l’irrigation des exploitations agricoles à distance. L’Agropad a été crée par Global Initiative, une startup dans le domaine de l’agronomie.
Le changement climatique a un impact sur la hausse des prix des produits locaux sur le marché. Cette hausse des prix s’explique par de la baisse de la productivité des agriculteurs.
L’agriculteur peut mettre le dispositif d’irrigation en marche sans avoir à se déplacer, une fois qu’il installe l’application dans son téléphone portable.
L’objectif de l’AgroPad est de permettre aux agriculteurs de gagner en temps. Mais surtout d’augmenter leurs rendements et réduire l’impact du changement climatique. Il règle aussi le problème de main d’œuvre grâce aux nouvelles technologies.
Les capteurs donnent les renseignements en permanence à l’utilisateur, sur les besoins de son champ. En cas d’insuffisance, les canaux d’irrigations se mettent en marche et ravitaillent les plantes en eau et en engrais nécessaire. En plus de l’irrigation des champs, le système permet aussi le contrôle et la géolocalisation du bétail. Les batteries du système peuvent durer quatre jours selon le promoteur, même en absence du soleil, un avantage en saison pluvieuse!
L’Agropad est utilisé par de nombreux agriculteurs au Cameroun et Erik Tiam a reçu plusieurs reconnaissances grace à son invention.
Ces jeunes Africains traduisent du contenu vers les langues locales pour lutter contre le covid-19
Les mots « masque facial » et « désinfectant pour les mains » sont maintenant familiers dans le monde entier. Mais pour les locuteurs isiZulu en Afrique du Sud, ces termes n’existaient pas il y a un an, jusqu’à ce qu’un groupe de volontaires se soit tourné vers Internet pour les créer.
Des publications de Wikipédia en langues autochtones aux bibliothèques de mots numériques, les amateurs de langues africaines se connectent en ligne pour préserver et créer des mots et du contenu pour les générations futures. Un effort qui a été renforcé par la pandémie de coronavirus.
Démocratiser l’information
Les volontaires du programme WikiAfrica traduisent du contenu en ligne dans près de 20 langues africaines. Il s’agit du twi, le swahili, l’afrikaans et le dagbani, selon une porte-parole de la Fondation Moleskine.
Les articles traduits ont été consultés plus de 500 000 fois, affirme l’organisation à but non lucratif. La Fondation Moleskine se concentre sur des projets culturels et aide à former des traducteurs à travers le continent.
Au début de la pandémie, les responsables de l’organisation ont remarqué que la quantité de contenu sur le COVID-19 sur Wikipédia en langues africaines faisait défaut, a déclaré le directeur général et co-fondateur Adama Sanneh.
« Nous avons donc créé une campagne pour dire à tous les locuteurs de langue africaine : « Si vous connaissez la langue, veuillez traduire une partie de ce contenu de l’anglais ou du français ou du portugais », » il dit sur Zoom.
Une partie de WikiAfrica consiste à « démocratiser l’information », a déclaré Lwando Xaso, avocat et activiste de Constitution Hill Trust, une organisation de promotion de la constitution sud-africaine qui s’est associée au programme.
Accès libre
Partout dans le monde, divers efforts pour traduire des documents dans les langues maternelles africaines génèrent un contenu culturellement pertinent. Tout en aidant à garder les langues autochtones en vie.
Les Nations Unies au Nigéria ont créé un portail de désinformation COVID-19 qui répond aux questions fréquemment posées en yoruba, haoussa et igbo.
Et l’année dernière, 30 jeunes Africains se sont réunis pour traduire les directives de santé publique COVID-19 dans 18 des langues africaines les plus courantes.
Cela, après que le chercheur de l’Université de Cambridge, Ebele Mogo, se soit adressé aux médias sociaux pour demander une aide à la traduction.
Lorsque COVID-19 a été enregistré pour la première fois dans son pays d’origine, le Nigéria, Mogo s’inquiétait de la propagation de la désinformation, comme des astuces pour manger de l’ail ou prendre des bains chauds pour conjurer le virus, selon le site Web de son projet.
« Pour ceux qui ont peur de ne pas pouvoir se protéger eux-mêmes et leurs familles, il peut être trop facile de suivre les mauvais conseils », a-t-elle déclaré sur le site.
En dehors de la pandémie, depuis 2011 l’Université de Boston a constitué des référentiels de manuscrits d’Afrique de l’Ouest numérisés et menacés.
Ces initiatives sont inestimables, a déclaré Mahlatse Hlongwane, 24 ans, étudiante et volontaire WikiAfrica de la province sud-africaine de Limpopo, qui a déclaré avoir trouvé de nouveaux mots sesotho liés à la pandémie en écoutant la radio et en entendant de nouveaux termes utilisés de manière informelle.
Mais, a-t-elle ajouté, les gens ont besoin de plus de sites Web mobiles pour accéder au contenu de leurs téléphones mobiles, en particulier dans les zones rurales où les informations sont rares.
« J’aimerais que les gens sachent que les informations sont en ligne pour eux », a déclaré Hlongwane.
Les avocats de Tanzanie devraient bientôt être sur les étagères sud-africaines
Au cours des dernières semaines, il y a eu une pénurie saisonnière d’avocats qui a rendu la vie difficile (et beaucoup plus chère) à certains Sud-Africains pour obtenir leur fruit vert favori. Il y a actuellement une pénurie d’avocats, car ils sont hors saison, déclare Derek Donkin, PDG de la SA Subtropical Growers ’Association.
La saison des avocats sud-africains s’étend de la fin de février à mi-octobre. Il existe certaines régions de production en Afrique du Sud où les avocats peuvent être récoltés de novembre à janvier, mais ils ne représentent qu’une petite partie de la récolte, a déclaré Donkin.
Sur son site Web, Woolworths a averti qu’il subissait des pénuries d’approvisionnement : « Nous travaillons dur pour résoudre ce problème et nous nous excusons pour la gêne occasionnée. »
Enfin, cette crise sera résolue très prochainement.
Les avocats de Tanzanie devraient bientôt être offerts dans les marchés sud-africains
Les avocats de Tanzanie devraient être en vente en Afrique du Sud avant la prochaine saison – et peuvent aider à modérer les prix actuellement au-dessus de R30 pour un seul fruit dans certains cas.
Les gouvernements d’Afrique du Sud et de Tanzanie se sont mis d’accord sur la manière de finaliser la vérification des mesures phytosanitaires sans inspection physique, ce qui est entre difficile et impossible en raison du Covid-19, a déclaré un groupe commercial cette semaine.
S’assurer que les avocats importés ne sont pas accompagnés de ravageurs dangereux devrait être le dernier obstacle majeur pour les importations, de sorte que toutes les exigences devraient maintenant être satisfaites à temps pour la prochaine récolte majeure de la Tanzanie en mai.
Cela, à son tour, peut aider à maintenir les prix bas en Afrique du Sud.
L’Afrique du Sud a connu une grave pénurie saisonnière d’avocats au début de 2021, malgré des volumes de production locale très importants. Pendant ce temps, la Tanzanie a développé de manière agressive sa culture d’avocat, de près de zéro il y a dix ans à des valeurs d’exportation qui se comptent maintenant dans les centaines de millions de rands.
On estime que 50 000 agriculteurs tanzaniens sont actuellement impliqués dans la production d’avocat, les exportations étant principalement destinées à l’Europe. Des avocats frais haut de gamme figurent sur les étagères de plusieurs grands supermarchés.
Le plan de biosécurité pour les avocats tanzaniens en Afrique du Sud est en cours d’élaboration depuis mi-2020, et au moins un importateur avait espéré importer des fruits pour la consommation locale. Mais l’incapacité de vérifier les mesures en place en Tanzanie a contribué aux retards.
Les producteurs sud-africains, qui ont eu du mal à répondre à la demande, ont soutenu le processus de certification des fruits tanzaniens pour l’importation. Sur d’autres marchés, notamment aux États-Unis, les importateurs ont fait valoir que des prix plus stables et moins de pénuries ont profité aux producteurs locaux grâce à une demande et des prix plus élevés.
La superficie plantée d’avocat en Afrique du Sud augmente d’environ 5% par an, mais les arbres prennent six à huit ans avant de devenir pleinement productifs.
Un jeune Burkinabè crée un masque intelligent anti-Covid

Ca y est ! Nathanaël Thierry Kopia, jeune entrepreneur burkinabè dans le numérique et le social, crée le « S-MASK » un masque intelligent pour donner un coup de frein efficace à la propagation du coronavirus. C’est une première au Burkina Faso et voire même au monde.
Depuis plus d’une année, la pandémie provoquée par le COVID-19 a plongé le monde entier dans une situation d’urgence extrême. Si des vaccins sont en phase d’expérimentation actuellement, le meilleur moyen préconisé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour se protéger est d’appliquer les gestes barrières. Parmi eux, le port du masque demeure une recommandation incontournable. Comment la technologie, dans un monde de plus en plus connecté, pourrait apporter une solution pour lutter contre cette pandémie ? Une question essentielle à la base des recherches de Nathanaël Thierry Kopia et ses collaborateurs depuis février 2020.
C’est le 20 mai 2020 que le S-Mask voit le jour avec son premier prototype S-M, K20.01. L’invention concerne le domaine de la santé et de la technologie. En effet, c’est un masque intelligent muni de capteurs électroniques, qui transmettent des informations de certaines constantes sanitaires de l’utilisateur sur une application mobile via la connexion Bluetooth du smartphone.
Cette application mobile affiche de multiples informations tel que la température corporelle et son rythme cardiaque. Elle peut également faire un diagnostic de l’état de santé de l’utilisateur en croisant les données reçues du masque. Elle envoie des notifications de mise en garde en cas d’approche d’une zone à forte contamination de la pandémie COVID-19 grâce à la géolocalisation. Cette invention regorge de bien d’autres fonctions utiles.
Par ailleurs, le masque favorise la respiration d’un air agréable et pur grâce à au filtre en coton changeable qui peut être inodore ou parfumé.
C’est à la fois un équipement d’information, d’autocontrôle et un dispositif de protection contre l’inhalation de poussières nocives, d’agents pathogènes, fumées, vapeurs, de gaz, ainsi que contre diverses maladies transmissibles dans l’air.
A la date du 08 octobre 2020 Nathanaël Thierry KOPIA et son équipe composée de Franck Lionel OUEDRAOGO, Abdou KABORE, Ismaël Isaac Lawako KI, Ben Isaac COMPAORE et de Hamadou DORO SMASK, ont déposé la demande de brevet d’invention du S-MASK Version S-M20.02 à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) .
Aujourd’hui, le Burkina Faso à l’instar des autres pays africains, est confronté à une énorme crise sanitaire. Il connait un nombre insuffisant d’infrastructures sanitaires et de professionnels de la santé pour faire face. Le nombre de personnes contaminées par le COVID-19 progresse chaque jour et continue d’endeuiller de nombreuses familles. Selon l’écrivain et psychiatre Martiniquais Frantz Fanon : « Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir ». Nathanaël Thierry KOPIA, lui a trouvé sa mission : sauver des vies, en donnant libre court à son génie créateur. Il apporte ainsi des solutions numériques locales à un problème mondial.
Son invention a juste besoin d’un peu d’aide pour passer au stade industriel. Rejoignez ceux qui soutiennent cet inventeur et son équipe. Participez à ce formidable projet pour une vie plus saine et plus sereine.
Contacter Thierry KOPIA : thierry.kopia@gmail.com
Rodrigue SEKONE
A la découverte du nzango au Congo
Au Congo-Brazzaville, les sports classiques côtoient une célébrité locale: le nzango. Allons à la découverte du nzango.Cette discipline traditionnelle a toutefois ses règles singulières. SNA vous amène à sa (re) découverte.
Le nzango a connu une période faste au Congo. Mais ça, c’était avant la crise sanitaire de la Covid-19. Tout commence pratiquement en 2005, lorsque le ministère des Sports initie les premières compétitions. C’était sous l’impulsion de l’Association sportive innovatrice du nzango moderne, créée par Guy Noël Titov Passy.
Un enjeu important
L’objectif reste la santé des femmes. «La pratique de ce sport contribue à lutter contre le surpoids et l’obésité. Elle permet à la femme de se maintenir en forme. Elle épargne aussi à nos compatriotes de lourdes dépenses de santé», soutient Titov Passy, cadre au ministère congolais de la Santé. L’enjeu est si important qu’aujourd’hui, plus de 190 équipes sont recensées. Elles sont créées par des églises, des entreprises publiques ou privées, des ONG ou des acteurs politiques.
Mais qui dit compétition, dit règles. Le Nzango se pratique sur un terrain de 16 mètres de long et huit de large avec deux arbitres. Chaque équipe est composée de 11 joueuses et six réservistes. Les deux équipes se font face sur un terrain délimité par une ligne centrale.
Au rythme de comptines, les joueuses battent leurs mains et sautillent en croisant ou décroisant les jambes. La partie se déroule en duels. La joueuse qui attaque fait gagner un point ou «pied» à son équipe lorsque son adversaire croise un pied opposé au sien (droit et gauche par exemple). Elle perd lorsque l’adversaire croise le même pied qu’elle (gauche et gauche par exemple). L’objectif est de marquer des points ou «pieds». La partie dure 50 minutes avec une pause de 10 minutes.
Cependant, bien avant cette codification, le nzango a une longue histoire. Elle remonte, d’après des documents administratifs, à l’époque coloniale. Notamment, pendant la construction du chemin de fer Congo-Océan reliant Pointe-Noire à Brazzaville sur 515 kilomètres. C’était entre 1921 à 1934.
L’olympisme à tout prix
Les colons recrutèrent donc de la main-d’œuvre dans toute l’Afrique équatoriale française (AEF). Notamment en Centrafrique où le peuple Sango fournit pas mal d’ouvriers et de manœuvres. Ces travailleurs, après avoir cassé à la main de gigantesques rochers toute la journée pour creuser des tunnels dans le Mayombe, se divertissaient le soir venu en admirant leurs femmes jouer au nzango.
La légende raconte qu’un jour, un Blanc demande: «A quel jeu jouent ces femmes?». Un autochtone (Yombé) lui répond alors: «C’est le jeu des Sango». Et le Blanc transcrit mal: «Nzango».
Toutefois, le nzango survit à la fin des travaux du chemin de fer pour se répandre dans plusieurs pays d’Afrique centrale comme la RDC, le Gabon et le Cameroun. Le jeu est pratiqué dans les villages, les quartiers ou les écoles avant de devenir une discipline sportive à part entière.
De sorte que le Congo se bat pour en faire un sport olympique. Mais le chemin semble encore bien long. Et difficile…
L’entrepreneure kenyane Nzambi Matee primée par l’ONU
L’entrepreneure kenyane Nzambi Matee primée par l’ONU. Elle a créé une machine permettant de recycler les déchets plastiques en pavés. Cette création lui a valu la nomination de Jeune Championne de la Terre. Un prix mondial de l’UNEP qui offre financement et mentorat à des personnes qui s’attaquent aux problèmes les plus urgents de notre ère.
Avant l’entrée en vigueur de l’interdiction du plastique en 2017, le Kenya en produisait environ 4 000 tonnes par mois et 100 millions de sacs étaient proposés par les supermarchés. Le pays ait mis en place des lois strictes contre l’utilisation du plastique. Cependant, il fait encore face à la pollution causée par ce matériau non biodégradable.
Nzambi Matee est diplômée en sciences des matériaux. Elle travaillait comme ingénieure dans l’industrie pétrolière kenyane lorsqu’elle a eu l’idée de lancer son entreprise. Cela, après avoir fait le constat de l’abondance de sacs en plastique dans les rues de Nairobi. En 2017, elle décide de quitter son emploi et crée un petit laboratoire dans le jardin de sa mère. Elle fabriquait et testait des pavés obtenus à partir d’une combinaison de plastique et de sable.
Au bout de plusieurs essais, elle reçoit une bourse pour suivre un programme de formation en entrepreneuriat social aux États-Unis. De là, elle met au point une machine à fabriquer des pavés. De retour au Kenya, elle crée son entreprise, Gjenge Makers, dans la capitale. Ses pavés ont une température de fusion supérieure à 350°C, et seraient beaucoup plus résistants que leurs équivalents en béton.
Son objectif, répondre au défi du logement dans le secteur de la construction. Pour ce faire, elle a établi des partenariats avec différents fabricants d’objets en plastique. Son équipe, constituée de ramasseurs d’ordures informels, collecte les déchets. Grâce à cette activité, l’entreprise de Nzambi Matee leur assure un revenu stable.
« Nous avons autonomisé financièrement plus de 112 personnes, dont la majorité sont des femmes et des groupes de jeunes qui sont nos partenaires pour la fourniture des déchets plastiques et l’étape de prétraitement de notre processus de production », a-t-elle affirmé sur le site de l’ONU.
Le parcours de Nzambi Matee lui a valu la nomination de Jeune championne de la Terre par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). Elle a reçu un financement de démarrage d’un montant de 10 000 dollars . Ce qui lui permettra d’augmenter sa capacité de production actuelle de 1 500 pavés par jour. Ainsi elle pourra satisfaire la demande de plus en plus grandissante.
Ecrit par Aïsha Moyouzame de Agence Ecofin.